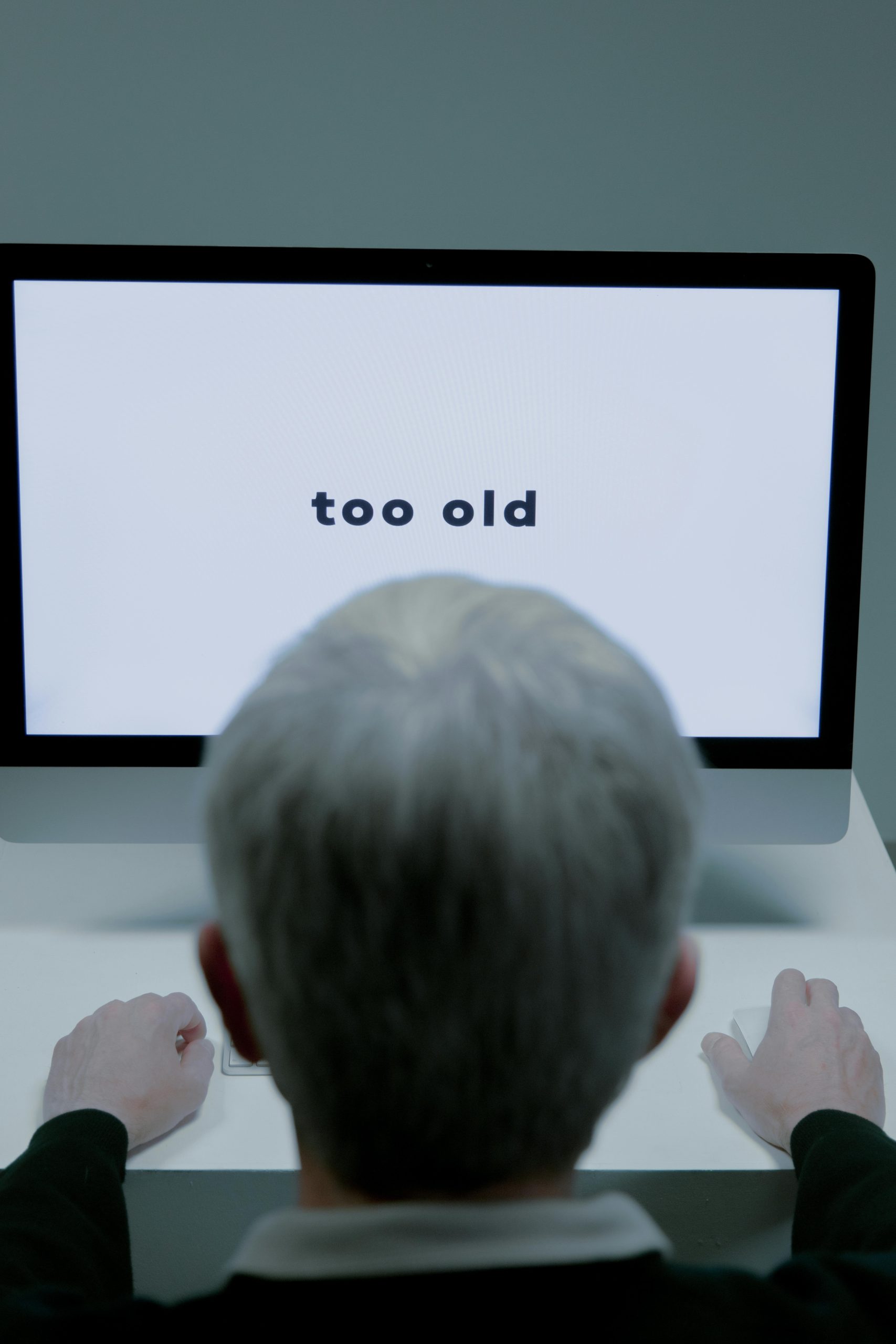Budget Bayrou : mieux ou pire que le budget Barnier ?
Sauf retournement de situation, François Bayrou devrait parvenir à faire passer le projet de loi de finances pour 2025 ce mercredi à l’Assemblée nationale. Sa copie est-elle meilleure que celle de Michel Barnier ?
Deux mois et un jour après un épisode historique de la vie politique française, l’Hexagone en vivra-t-il un second ? A priori, François Bayrou devrait échapper, ce 5 février, au sort de Michel Barnier, censuré par l’Assemblée nationale le 4 décembre dernier.
Ce jour-là, le Premier ministre était tombé après avoir utilisé l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi de finances pour la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. Son successeur prend le même risque, ce mercredi, cette fois pour le projet de loi de finances (PLF).
En deux mois, comment ont évolué ces deux textes qui déterminent le budget du pays pour l’année 2025 ? Dans les grandes lignes, les textes se ressemblent : ils prévoient une hausse des recettes fiscales, une baisse des dépenses et le maintien de la politique de l’offre d’Emmanuel Macron. Mais, dans le but d’obtenir une non-censure de la part du Parti socialiste (PS), François Bayrou a rendu la potion un peu moins amère que celle de Michel Barnier.
En acceptant de réduire le déficit moins vite, le nouveau Premier ministre a pu faire quelques gestes. 4 000 postes d’enseignants, qui devaient disparaître, seront par exemple maintenus. De même, les collectivités locales ne seront plus privées que de 2,2 milliards d’euros par rapport au budget 2024, alors que Michel Barnier leur en avait retiré 5.
Au total, que retenir du nouveau budget, constitue-t-il un véritable progrès ? Nous avons choisi trois thèmes principaux (fiscalité, santé, écologie) pour répondre à la question.
1/ Fiscalité : moins d’austérité en 2025, mais…
Le gouvernement de François Bayrou, comme celui de Michel Barnier, vise une réduction du déficit budgétaire : en 2025, avec moins de dépenses et plus d’impôts, l’action publique tirera la croissance vers le bas. Incontestablement donc, la France entre bien dans une politique d’austérité.
Mais elle sera moins radicale que prévu : l’objectif affiché est désormais d’atteindre un déficit équivalent à 5,4 % du PIB, contre 5 % pour le gouvernement précédent. Si l’on se concentre sur le déficit structurel – hors conjoncture et mesures ponctuelles et temporaires –, selon le Haut Conseil des finances publiques, il resterait au niveau – élevé – de 4,7 points du PIB, soit 0,2 point de plus que celui de Michel Barnier. Bercy a donc légèrement relâché la pression à la réduction des déficits pour cette année.
Une partie du chemin passe par la baisse des dépenses de l’Etat, de 1,6 % en volume. « Cette évolution serait la plus forte baisse en volume de la décennie » commente le Haut Conseil.
Un coup de rabot quasiment généralisé sur toutes les missions, sans objectif politique clair
C’est ce qui a fait dire au président de la Commission des Finances Eric Coquerel, à la tribune de l’Assemblée nationale le 3 février, que « le budget soumis aujourd’hui à notre vote est un budget pire que celui de Michel Barnier », dans la mesure où il va plus loin dans la baisse des dépenses. Qui plus est par un coup de rabot quasiment généralisé sur toutes les missions, sans objectif politique clair. Une indifférenciation qui inquiète le Haut Conseil.
Mais, dans le même temps, les hausses attendues des prélèvements obligatoires ont été révisées à la baisse (- 10,6 milliards d’euros). Une grande partie (6 milliards), s’explique par la baisse de la prévision de croissance du PIB pour cette année, passée de 1,1 % à 0,9 %. Cette moindre activité signifie moins d’argent dans les caisses.
De ce point de vue, Bercy pourrait connaître une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise : le consensus des économistes place plutôt la croissance française autour de 0,7 % cette année, soit encore moins de recettes fiscales que prévu.
La bonne : l’élasticité des recettes fiscales au PIB (le lien entre croissance du PIB et croissance des recettes) pourrait être meilleure qu’attendu. Bercy est resté sur une prévision prudente, estimant que cette élasticité sera inférieure à l’unité, pour la troisième année consécutive.
De quoi parle-t-on ? Une note technique du Haut Conseil des finances publiques explique que lorsque la croissance des salaires du secteur privé est plus faible que celle du PIB nominal (croissance réelle + inflation), compte tenu du poids des salaires pour nombre de recettes (cotisations sociales, impôt sur le revenu…), les recettes fiscales ont du mal à suivre. Cela explique en partie le dérapage budgétaire de l’année dernière. L’élasticité avait été mal anticipée par Bercy.
Mais, pour 2025, le gouvernement prévoit une hausse du PIB nominal de 2,3 % (0,9 % de croissance réelle et 1,4 % d’inflation) et des salaires de 2,5 %. L’élasticité des recettes fiscales pourrait donc revenir vers l’unité, ce qui ferait du bien aux caisses publiques.
L’application sur la seule année 2025 de la surtaxe d’impôt sur les très grandes entreprises représente une mauvaise nouvelle
Quoi qu’il en soit, la France restera avec un déficit budgétaire élevé qui réclamera de nouvelles mesures pour le budget 2026 et les suivants. De ce point de vue, l’annonce par Eric Lombard, le ministre des Finances, que la surtaxe d’impôt sur les très grandes entreprises, pour une recette de 8,5 milliards, ne s’appliquerait que sur la seule année 2025, représente une mauvaise nouvelle, de même que la réduction des allègements de cotisations sociales, qui ne sera que de 1,6 milliard d’euros, contre 4 milliards prévus dans le budget Barnier.
Si le gouvernement ne veut plus faire contribuer les entreprises au redressement des comptes publics, où va-t-il trouver l’argent ? Bercy a bien ouvert la possibilité d’un mécanisme visant à s’assurer que, dans le cadre des impôts actuels, le total de ce qui est payé par les très hauts revenus s’établisse à l’équivalent de 0,5 % de leur patrimoine. Mais ce taux reste faible : le G20 discute du même mécanisme, mais avec un taux à 2 %.
François Bayrou a clairement repoussé les décisions importantes à plus tard. Il va devoir dire dans les mois qui viennent comment il compte poursuivre le redressement des finances publiques. On verra alors s’il a troqué moins de rigueur aujourd’hui contre plus d’austérité demain.
Christian Chavagneux
2/ Santé : la casse évitée…pour le moment
Le vent du boulet n’est pas passé loin. A l’automne, le gouvernement Barnier voulait réduire les dépenses de santé en diminuant de 5 points le remboursement par la Sécurité sociale des consultations chez les généralistes et les sages-femmes. Il devait ainsi passer de 70 % à 65 %. Les médicaments devaient écoper du même régime.
A la clé : des « économies » qui étaient en réalité des transferts de charges vers les complémentaires, donc vers les assurés, à hauteur de près d’un milliard d’euros. Ces mesures sont absentes du budget Bayrou. Et le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a promis en commission des affaires sociales, le 27 janvier dernier, qu’il n’y aurait « pas de coup de Jarnac à coups de décrets ». Ouf !
Autre bonne nouvelle : le budget des hôpitaux est revalorisé. Il augmente de 3,8 %, au lieu des 2,6 % prévus par Michel Barnier. C’est un milliard d’euros de plus que prévu (109,6 milliards d’euros au lieu de 108,8). La hausse des cotisations à la Caisse de retraite des fonctionnaires hospitaliers, la CNRACL, qui allait peser sur les finances des hôpitaux à hauteur de 1,3 milliard d’euros selon la Fédération hospitalière de France (FHF), est lissée dans le temps (4 ans au lieu de 3).
Cela desserre un peu l’étau dans lequel sont pris des hôpitaux déjà très endettés (2 milliards d’euros cumulés en 2024, selon la FHF), et leur permet de récupérer un peu moins de 300 millions d’euros pour 2025.
Au total, le budget Bayrou affiche deux milliards d’euros de plus pour la santé que le premier budget Barnier présenté en octobre, avec 265,9 milliards d’euros au lieu de 263,9 milliards d’euros. En gros, ils se répartissent entre un milliard en plus pour les hôpitaux et un milliard sur les taux de remboursement qui ne baissent pas. Les Ehpad reçoivent, eux, 300 millions d’euros supplémentaires, au lieu des 100 millions prévus.
Ces mesures permettent de limiter la casse du service public hospitalier et de la couverture santé. Mais très relativement
Ces mesures permettent de limiter la casse du service public hospitalier et de la couverture santé. Mais très relativement. « Ce n’est évidemment pas un budget de gauche », a commenté dans Les Echos le député socialiste Jérôme Guedj à propos de l’ensemble du texte. Le ministre de la Santé a souligné qu’une fois adopté, il s’agira de penser au budget 2026, et d’engager des réformes structurelles.
Devant les députés de la commission des affaires sociales, il a détaillé : il y a un modèle à repenser qui n’implique pas nécessairement plus de moyens pour l’hôpital. Parmi les chantiers, la participation des soins de ville à la permanence des soins, une réorganisation autour de petites unités primaires pour soulager les urgences hospitalières, et la lutte contre les examens inutiles et pour l’efficience des prescriptions à l’hôpital.
Quant aux complémentaires, qui ont vu leurs tarifs flamber de 6 % en prévision des transferts de charge finalement remisés, le ministre entend ouvrir les discussions, soit pour une ponction, soit pour leur confier d’autres missions, comme le grand âge ou la prévention.
La logique d’ensemble n’a donc changé en rien. Témoin, le maintien de la « taxe lapin », qui doit pénaliser les patients n’honorant pas leur rendez-vous médical sans prévenir suffisamment longtemps à l’avance.
Comment tout cela est-il financé ? Le gouvernement veut serrer la vis à l’imagerie médicale, à la radiologie et à la biologie, et lutter contre la fraude. Il évite la discussion sur l’augmentation des recettes.
« Le sous-financement des dépenses de santé crée de la dette. Nous devrions avoir un débat sur le niveau de dépenses de santé que nous voulons assumer collectivement, et mettre en face les ressources », récapitule l’économiste Brigitte Dormont.
En attendant, le déficit de la Sécurité sociale, toutes branches confondues, devrait être de 23 milliards d’euros cette année, contre 16 milliards initialement prévus dans le budget Barnier.
Céline Mouzon
3/ Ecologie : une hausse qui cache des baisses
Sur le papier, la transition écologique est un petit peu mieux (ou moins mal) lotie dans le budget Bayrou du 3 février que dans le budget Barnier du 10 octobre. La mission « Ecologie, développement et mobilités durables » gagne en effet un milliard d’euros. Elle passe de 21,8 à 22,9 milliards en autorisations d’engagement, et de 20,5 à 21,7 milliards en crédits de paiement (hors inflation).
Au sein de la mission « Cohésion des territoires », la ligne « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » (programme 135), qui soutient notamment la rénovation thermique des logements, perd près d’un demi-milliard en crédits de paiement, mais conserve pratiquement son enveloppe – 2,7 milliards – en autorisations d’engagement.
Ce milliard supplémentaire pour la mission Ecologie n’est cependant en rien la traduction d’une plus grande préoccupation environnementale de François Bayrou par rapport son prédécesseur, et son discours de politique générale n’avait laissé aucun doute à ce sujet. Il n’est pas non plus permis de le considérer comme une concession faite à la gauche tant ce chiffre est en trompe-l’œil.
Il faut en effet regarder l’évolution des lignes dans le détail. L’une d’elles saute aux yeux : le « service public de l’énergie » voit ses crédits de paiement passer de 6,7 milliards d’euros dans le budget Barnier à 8,6 milliards d’euros dans le budget Bayrou, soit une hausse de deux milliards.
Sous cette rubrique se rangent principalement les dépenses publiques de soutien aux énergies renouvelables. Mais point, ici, d’explosion des investissements dans ce domaine, qui appellerait une hausse des subventions. C’est l’effet de l’évolution des prix de marché de l’électricité qui fait mécaniquement augmenter les dépenses de soutien1.
Par rapport au budget Barnier, le budget Bayrou a réduit d’un milliard l’effort en faveur de l’écologie
Si cette hausse de 2 milliards pour le service public de l’énergie a bel et bien une signification budgétaire, elle n’en a aucune en termes d’efforts climatiques. 2 milliards de plus pour le service de l’énergie et un milliard de plus pour la mission écologie dans son ensemble, donc. Autrement dit, par rapport au budget Barnier, le budget Bayrou a réduit d’un milliard l’effort en faveur de l’écologie en coupant dans les autres postes de la mission. Et même davantage si l’on intègre l’inflation.
Quelles lignes ont été sabrées ? En crédits de paiement, le Fonds vert pour les territoires, que le Sénat avait voulu amputer, a finalement été préservé, à quelques coups de rabot près. Idem pour les infrastructures de transports, la biodiversité, la « conduite et pilotage des politiques de l’écologie », la sûreté nucléaire.
La grande victime est la ligne « Energie, climat et après-mines » (programme 174), qui a une grande importance en termes d’action climatique. Elle voit en effet son budget 2025 passer de 2,1 milliards d’euros à 1,5 milliard.
Le projet de loi de finance sur lequel le gouvernement vient d’engager sa responsabilité est opaque sur le détail de ces coupes, mais on trouve toutefois dans ce programme 174 beaucoup de dépenses d’intervention pour accompagner la sortie des fossiles, comme les aides à l’acquisition d’un véhicule électrique ou le fonds chaleur de l’Ademe.
Du côté des recettes publiques, la taxe sur les billets d’avion, diminuée, rapporterait à l’Etat 800 à 850 millions d’euros, selon un parlementaire, au lieu du milliard escompté dans le projet présenté à l’automne.
Du point de vue de l’urgence climatique, le budget Bayrou fait pire que le budget Barnier. Surtout, il se place dans la continuité des régressions de plus en plus assumées depuis 2024… Comme si, au fond, trouver les moyens de réaliser 60 milliards d’investissements publics et privés additionnels chaque année pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre n’était plus un sujet.
Antoine de Ravignan
Source : https://www.alternatives-economiques.fr/budget-bayrou-mieux-pire-budget-barnier/00113944